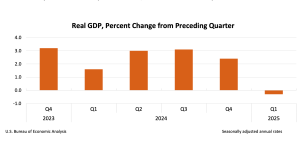Il y a douze hivers, en tant que journaliste du Wall Street Journal, j’ai passé deux semaines sombres à Copenhague à couvrir une série de négociations sur le réchauffement climatique considérées comme étant d’une importance existentielle pour la planète. Les pourparlers sur le climat de Copenhague en 2009 visaient à verrouiller les engagements des pays industrialisés à financer une transformation des énergies propres dans les pays en développement. Le sommet s’est terminé comme un raté – plus écrasant par les partisans de tous les côtés du débat sur la décarbonisation qu’une tentative de construire une coalition pour une transformation environnementale.
Depuis lors, cependant, la technologie a progressé d’une manière dont les militants pour le climat de Copenhague n’en rêvaient que. Pour un certain nombre de machines vertes – panneaux solaires, éoliennes, batteries – les coûts ont chuté et les installations ont grimpé en flèche. Dans de nombreuses régions du monde, selon des études, l’installation d’énergies renouvelables est maintenant moins chère que la construction de centrales au charbon. Les énergies renouvelables ont le vent en poupe.
Il n’y a qu’un seul problème : les émissions de carbone sont donc toujours là.
Jusqu’à la fin de cette semaine, les acteurs et les agitateurs de l’économie internationale sont réunis lors d’une autre conférence sur le climat, cette fois à Glasgow. Les ambitions se sont grandement développées ; aujourd’hui, les gouvernements et les entreprises promettent, d’une manière ou d’une autre, de réduire leurs émissions à « zéro net » d’ici le milieu du siècle. Pourtant, l’objectif à Glasgow reste en grande partie le même qu’à Copenhague : amener les plus grandes économies à investir davantage dans l’énergie propre dans les pays dont les émissions augmentent le plus rapidement.
Mais l’histoire des douze dernières années montre que les progrès des laboratoires et les investissements à l’étranger ne suffisent pas à décarboniser la croissance dans les pays qui comptent le plus pour l’avenir du climat – des pays comme l’Indonésie, la Malaisie et le Vietnam, et d’autres au-delà de l’Asie du Sud-Est, y compris en Amérique latine et en Afrique. Des stratégies viables pour recâbler les économies politiques de ces pays sont tout aussi importantes que l’équipement et l’argent, et plus difficiles à fournir.
Malgré la baisse du coût d’une énergie plus propre, ces économies émergentes et en développement, à l’instar des principales puissances économiques mondiales, n’ont pas réussi à modifier de manière significative leurs modes de consommation de ressources. C’est en grande partie parce qu’ils ont des secteurs puissants et des régions peuplées qui voient raisonnablement leurs intérêts comme liés à une production de carbone continue et sans contrainte. Financement offert pour les panneaux solaires et les éoliennes, ils ne les refusent pas. Mais en l’absence d’un avenir viable pour leurs investisseurs et leurs citoyens dont les moyens de subsistance dépendent depuis longtemps de la combustion de combustibles fossiles, ils ne changeront pas de manière significative. Quelque chose de plus fondamental doit changer.
Pour éclairer à la fois ce défi et un moyen de le contourner, plusieurs étudiants de l’Université de Stanford, où j’enseigne, et moi avons passé des mois à exploiter de nouvelles données pour analyser qui appelle les coups de feu pertinents pour le carbone dans le monde en développement, et comment ils s’en sortent ce. Nous nous sommes concentrés sur les infrastructures : les grands projets, tels que les centrales électriques, qui verrouilleront les trajectoires d’émission des économies émergentes pendant des décennies et détermineront ainsi l’avenir du changement climatique mondial.
Nos résultats, publiés le mois dernier dans un article de recherche dans iScience et expliqués dans un essai invité hier dans le New York Times, fournissent de nouvelles informations sur la façon dont l’argent change le climat. Ils jettent les bases d’une prochaine étape d’enquête dans ce que nous appelons le Stanford Climate of Infrastructure Project : clarifier pourquoi ces acteurs investissent comme ils le sont et comment ils pourraient être amenés à changer de manière significative.
Notre examen exploite deux ensembles de données que la Banque mondiale a collectées et que nous avons contribué à renforcer. Les données comprennent, pour les projets d’infrastructure dans le monde en développement, des détails sur les institutions qui fournissent des financements, combien elles fournissent et à travers quelles structures de financement elles le fournissent. L’un des ensembles de données de la Banque mondiale est accessible au public depuis des années. La banque a fourni l’autre à notre équipe de Stanford pour analyse et prévoit de la publier publiquement d’ici l’été prochain.
Ensemble, ces deux ensembles de données comprennent environ 80 % des projets d’infrastructure en cours dans les économies émergentes et en développement, selon les estimations de la Banque mondiale. En d’autres termes, c’est un regard complet.
Dans un premier temps, nous avons évalué un type d’infrastructure : les centrales électriques, à la fois parce qu’elles dictent de manière si significative les trajectoires d’émissions futures et parce qu’il existe des méthodologies acceptées pour projeter, sur la base de ce type de données, les émissions à long terme des centrales électriques. .
L’intégration de ces méthodologies dans les données nous a conduit à des résultats intrigants. Certains soutiennent, avec une nouvelle granularité, des hypothèses de longue date sur la trajectoire du carbone des infrastructures des pays en développement. D’autres renversent ces hypothèses. Trois sont particulièrement remarquables.
On clarifie l’énormité du défi climatique. Nous estimons, sur la base de nos données, que 52 % de la nouvelle production d’électricité « exécutée » dans les économies émergentes de 2018 à 2020 est trop intensive en carbone pour atteindre l’objectif de maintenir la température mondiale moyenne à moins de 1,5 degré Celsius de la température préindustrielle. niveaux. « Exécuté » est le jargon de la Banque mondiale pour avoir reçu un financement suffisant pour continuer. Ces trois années sont celles que les données de la Banque mondiale nous permettent de suivre, mais elles sont particulièrement éclairantes. Ils constituent le statu quo à forte intensité de carbone – un statu quo que de nombreux gouvernements et entreprises promettant maintenant de réduire leurs émissions au cours du prochain quart de siècle ont, au moins jusqu’à l’année dernière, été assez heureux de financer.
Une autre découverte permet de clarifier pourquoi la nouvelle infrastructure est si intensive en carbone. Les chercheurs ont de plus en plus cherché à comprendre les implications carbone du financement des infrastructures dans les économies émergentes et en développement ; beaucoup s’est concentré sur les centrales électriques au charbon, car le charbon est le combustible fossile le plus carboné. Mais notre analyse suggère que l’accent mis sur le charbon est de plus en plus obsolète. Alors que les institutions financent moins de centrales électriques fonctionnant au charbon, elles financent de plus en plus celles qui brûlent du gaz naturel.
Nous prévoyons que, parmi les centrales électriques qui ont été exécutées dans les économies émergentes et en développement de 2018 à 2020 et qui figurent dans notre base de données, celles alimentées au gaz naturel émettront 80 % autant de dioxyde de carbone au cours de leur vie que celles qui brûlent du charbon. Et pratiquement aucune de ces centrales au gaz ne devrait, du moins de sitôt, capturer et éliminer leurs émissions de carbone. La tendance dominante à se concentrer sur le charbon en tant qu’épouvantail du signal dans le développement des infrastructures passe à côté de la question de plus en plus pertinente du gaz.
Une troisième conclusion aide à expliquer les deux autres et suggère un moyen de décarboner de manière significative les investissements dans les infrastructures dans le monde en développement en accélérant la transformation des économies politiques. Elle repose sur la capacité croissante des économies émergentes elles-mêmes à déterminer l’intensité carbone des projets d’infrastructure construits à l’intérieur de leurs frontières.
Tout comme une grande partie de l’analyse passée des impacts climatiques des infrastructures des pays en développement s’est concentrée sur le charbon, elle s’est concentrée sur le financement d’investisseurs étrangers – provenant de pays comme la Chine, le Japon, la Corée du Sud et les États-Unis, qui ont de vastes industries nationales ayant des intérêts dans la vente d’équipements et de services à forte intensité de carbone à l’étranger. Mais notre analyse révèle que les économies émergentes dans lesquelles la majeure partie de l’infrastructure mondiale est en cours de développement ont une influence croissante sur l’intensité carbone de cette activité.
Nous constatons que 44% de la capacité de production d’électricité exécutée de 2018 à 2020 dans les économies émergentes ne provenait pas de sources étrangères mais de sources nationales. En effet, les financiers nationaux ont financé autant de nouvelles capacités de charbon et de gaz naturel que les financiers étrangers. Nous constatons également que, bien qu’un financier étranger donné ait tendance à financer des projets d’infrastructure d’intensités carbone très différentes dans différents pays, un pays hôte a tendance à utiliser des fonds étrangers pour des projets ayant un profil carbone similaire.
Ces deux conclusions suggèrent que les pays hôtes ont plus de pouvoir qu’on ne le croyait auparavant pour prendre les devants qui façonneront le changement climatique.
Dans un sens, ce constat est désillusionnant ; cela indique que les investisseurs locaux n’ont jusqu’à présent pas été plus enclins à se mettre au vert dans un pays donné que ne l’ont été les investisseurs lointains.
Dans un autre sens, cependant, il offre des raisons d’espérer. Cela montre que les institutions nationales pourraient s’avérer une force puissante pour décarboniser les investissements dans les infrastructures dans les pays où les plus gros portefeuilles de ces projets sont en cours de développement.
Encourager ces institutions nationales à assumer ce rôle nécessiterait, entre autres, des politiques pour amortir le coup porté aux industries et aux personnes longtemps dépendantes des efforts à haute teneur en carbone. Effectuer ce type de changement structurel dans une myriade d’économies politiques est un type de défi différent – à certains égards, plus difficile – que d’innover un panneau solaire plus efficace ou de persuader une institution financière étrangère d’envoyer un chèque d’énergie propre plus important. Mais essayer de faire face au changement climatique sans cela n’a pas fonctionné.
Depuis la conférence sur le climat de Copenhague en 2009, le coût des énergies renouvelables s’est effondré et les investissements dans celles-ci ont grimpé en flèche. Pourtant, les émissions de carbone sont toujours en hausse. Réaliser les promesses d’émissions nettes nulles d’ici le milieu du siècle nécessitera plus qu’une technologie plus propre et des contrôles plus importants. Il faudra un capitalisme plus sophistiqué. Le moulage de cette nouvelle économie politique sera désordonné. Et la conférence de Glasgow ne semble pas susceptible de faire grand-chose à ce sujet. Alors que l’accent dans la lutte contre le climat se déplace de l’Écosse vers les économies émergentes et en développement du monde entier, les décideurs politiques et les investisseurs doivent se salir les mains.
La source: www.brookings.edu